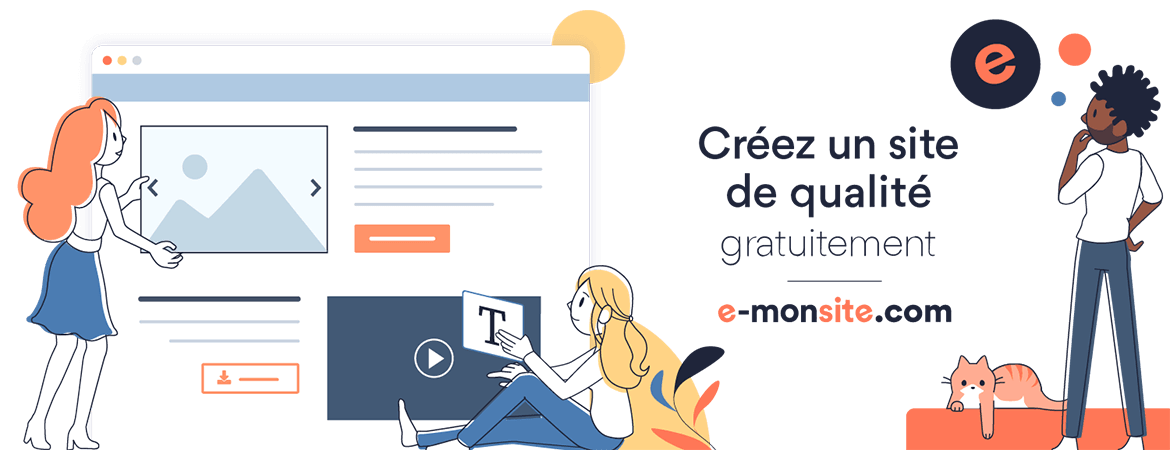Glossaire
On 09/09/2020
La fièvre survient lorsque la valeur de référence du centre thermorégulateur hypothalamique ou thermostat hypothalamique devient supérieure à la température normale. La température normale d'une personne âgée étant de 36,2 à 37,2°C.
Physiopathologie
La physiopathologie de la fièvre est complexe. La fièvre se produit entre autre lors d'une infection dans le cas d'une réaction de la phase aiguë où les substances provoquant la fièvre appelées pyrogènes , sont à l'origine du déplacement de la température de référence du centre thermorégulateur hypothalamique.
Les pyrogènes existent sous deux formes: les pyrogènes endogènes et exogènes.
Les pyrogènes exogènes dont il est question sont des fragments d'agents pathogènes tels que (les virus, les bactéries, les protozoaires, et les champignons), des toxines, des médicaments, des inducteurs comme les cellules cancéreuses ou leucémiques. ces pyrogènes exogènes sont opsonisés par les macrophages et déversent des nombreux pyrogènes endogènes notamment ( les i'terleuquines -1Alpha, 1Béta, 6, 8 et 11), l'interféron Alpha2 et Y, le Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF), le TNF béta, les Macrophages Inflamatory Proteins(MIP) et l'interleukine1 appelée pyrexine.
Tous ces pyrogènes endogènes arrivent à l'hypothalamus à travers la circulation sanguine et il y a la libération de la noradrénaline et de l'histamine qui induit la libération d'acide arachidonique par le neurone hypothalamique.
L'acide arachidonique va être transformé en prostaglandines E2 sous l'action de la cyclooxygénase. Les prostaglandines E2 vont stimuler le centre thermorégulateur hypothalamique en élevant la température de référence et on aboutit à la fièvre.
Notes : il faut savoir que le CTRH peut être déréglé par: un choc direct en cas des traumatismes crânio-céphaliques, en cas d'hyperthyroïdie par accroissement excessif du métabolisme cellulaire induit par la thyroxine.
Quel est le rôle de la fièvre ?
L'élévation thermique a un rôle dans l'activation de certains processus de défense notamment l'activation des lymphocytes, et la production des anticorps du fait de l'action des cytokines endogènes.
On appelle hyperthermie, une élévation physiologique de la température qui peut survenir selon certaines circonstances. Exemple : lors d'un effort physique intense, une exposition à la chaleur. En cas d'hyperthermie les mécanismes de thermolyse peuvent sont dépassés et la température ne peut pas être maintenue à la valeur normale de 37°C. Elle reste plutôt inchangée.
La situation devient beaucoup plus dangereuse lorsque la température du corps atteint une valeur de 40,5°C puisque le cerveau est incapable de la supporter. Si cette situation persiste, on va observer une défaillance du CTRH: la sudation s'arrête, la personne devient confuse et perd la connaissance. Il va se produire un œdème cérébral avec des lésions du système nerveux central. Tout ceci provoque la mort en cas d'absence d'une aide extérieure rapide.
Les étapes de la fièvreLa fièvre a cinq étapes qui sont
- La sensation de froid.
- Les frissons
- L'augmentation de la température.
- La défervescence.
- Le bien être.
Lutte contre la fièvre
Pour lutter contre la fièvre, on recours aux antipyrétiques : Aspirine, Paracétamol et Novalgine. Ces médicaments bloquent la cyclooxygènase ( un enzyme qui catalyse la réaction induisant la formation des prostaglandines.
Le bain froid agit sur le récepteur de la chaleur au niveau du sang puis que le sang entre en contact avec les neurones hypothalamiques et supprime la formation de la noradrénaline à ce niveau.
On 09/09/2020
On 09/09/2020
L'administration d'un médicament par voie injectable permet dans une large mesure l'action rapide, le dosage du produit, et l'introduction du médicament dans la circulation sanguine sans subir des modifications au niveau du tube digestif. Donc, avant d'administrer un produit injectable il faut :
- Vérifier la prescription médicale.
- Vérifier le nom du médicament, son action et ses effets secondaires.
- Le dosage et la posologie.
- La voie d'administration.
- La date d'expiration.
- Connaître le malade à injecter et sa fiche ou son cardex.
Ce sont les 5 justes : juste malade, juste médicament, juste posologie, juste voie d'administration, et juste date d'expiration des médicaments.
Pour faire une injection, les matériels suivants sont nécessaires : Un chariot ou un plateau sur lequel on mettra les matériels se soins notamment une seringue avec son aiguille stérile de taille appropriée selon la quantité de médicament à administrée ou l'état physique du patient, un bocal contenant le désinfectant, l'ouate (coton) imbibé pour désinfecter le site d'injection ou pour s'en servir à couper les ampoules en absence d'une lime, les médicaments forme injectables (ampoules ou flocons), l'eau distillée pour diluer les médicaments contenant dans les flacons, un champ stérile pour couvrir le plateau ou le chariot qui contiendra les matériels, un bassin réniforme comme poubelle, une étiquette pour préciser le nom du patient, un garrot pour injection intraveineuse.
Nous distinguons cinq types d'injection à savoir :
-Injection intramusculaire (IM).
-Injection intraveineuse (IV).
-Injection sous-cutanée (SC).
-Injection intradermique (ID).
-Injection intra rectal (IR).
Mais, il existe aussi une injection intra osseuse.
C'est une injection que l'on donne dans la face antérieure de l'avant bras et qui a une réabsorption très lente.
Indications : vaccin BCG, testes allergiques, test à la tuberculine ou de mantoux, traitement des névralgies par vitamine, recherche de la sensibilité à l'égard de certaines substances.
Techniques : désinfecter la peau et laisser sécher pour ne pas tuer les produits, aspirer le produit contenant dans l'ampoule ou le flacon, chasser le bulle d'air, tendre la peau avec le pouce de la main gauche, piquer et introduire l'aiguille dans le derme à un angle de 15 degré par rapport à la peau, injecter la solution aspirée, placer le tampon stérile et sec à la base ou se trouve l'aiguille pour retirer l'aiguille d'un geste rapide, avertir le malade de ne pas se gratter sur l'endroit de l'injection, se laver les mains, noter les formalités administratives, puis remettre les matériels de soins à leur endroit approprié.
Si c'est le vaccin BCG que vous avez administré, il faut avertir lamère de l'enfant qu'une réaction locale tardive peut toujours survenir et qu'elle ne doit pas avoir peur.
C'est l'introduction d'une solution médicamenteuse dans la veine avec une seringue. Cette injection est choisie quand il faut vraiment agir très vite pour sauver le patient , ou qaund on est devant un malade en coma. puisque les résultats de cette injection sont immédiats, voilà pourquoi il est très capital de savoir l'action, le dosage et la posologie du médicament avant de l'administrer pour éviter le risque de commettre les dégats.
Site d'injection: l'injection intraveineuse est faite dans toutes les veines accessible, de préférence les veines de l'avant-bras (veines de l'anesthésiste) et celles du dos de la main. Les matériels de l'injection sont presque les-mêmes, mais ici s'ajoute le cathéter, le garrot, la protection du lit et une chaise pour s'asseoir.
Techniques : sans perfusion, verifier la prescription et les récommandations médicales, se préparer, porter les gants, installer le patient dans la position de décubitus dorsal ou en position assise si elle est capable de s'asseoir, choisir le bras de l'injection, appliquer le garrot en le serrant modérément, demander au patient de serrer et déserrer les doigts comme si il fesait un coup-de-poinds pour juffler quelqu'un, placer la protection sous le bras, désinfecter le site de l'injection en passant une seule fois, stabilisser la veine en faissant un petit massage, tenir la seringue ou le cathéter à un angle de 30°c l'aiguille par rapport à la peau, le biseau de l'aiguille tourner vers le devant en haut, piquer la seringue et pénétrer la peau avec l'aiguille dans la veine et aller progressivement en aspirant pour voir qu'une veine a ramenée du sang, dès que possible, injecter lentement (1ml par minute) selon la prescription, vérifier de temps en temps si l'aiguille ou le cathéter est toujours en place, observer les réactions du malade à l'injection et lui demander de respirer lentement bouche grande ouverte pour lui éviter par exemple les nausées et vomissements qu'entrainent certains produits. L'injection terminée, rétirer l'aiguille en désinfectant en même temps le site de l'injection sans oublier de faire une petite pression pendant quelques secondes, réinstaller le patient dans sa position initiale, remercier le patient, remettre les matériels de soins en ordre, se laver les mains, puis noter les soins dans le dossier du malade. NB : Une injection normale ne doit pas être très douloureuse, ni avec une surélévation de la peau.
Le site d'injection dépend de la taille et de l'état du patient, de la quantité de produit à administrer, devla quantité des tissus musculaires disponibles pour l'injection, de la proximité du nerf et des vaiseaux sanguins.
Les différents sites de l'injection intramusculaire sont : la région fessière, le haut du bras, et la région de la cuisse.
La région fessière : le patient en position de décubitus latéral, ventral ou en position débout, identifier l'endoit à piquer en divisant la fesse en quatre quadrants. On utilise souvent le muscle fessier.
-On trace une ligne horizontale au dessus de la ligne inter-fessière (le plis fessier) jusqu'au grand trocater (épine illiaque).
-Tracer une deuxième ligne dans le sens vertical en allant de la pointe de l'omoplate jusqu'en bas de la fesse.
-Faire l'injection dans le quadrant supéro-externe de la fesse afin d'éviter de piquer les nerfs sciatiques.
Le haut du bras : pour ce qui est de cette région, on utilise le muscle déltoide. Endroit choisi seulement quand il s'agit des petites quantités des médicaments. Il est interdit d'injecter les antibiotiques dans la région déltoides car ils sont très douloureux.
La région de la cuisse : on utilise le muscle vaste externe et l'injection se donne dans la face externe de la cuisse. Pour trouver l'endroit, on divise la cuisse en 3 parties et on injecte dans le tiers moyen.
Techniques de l'injection : se laver les mains, verifier la prescription, placer le patient dans une position confortable, choisir l'endroit de l'injection, désinfecter la peau, chasser le bulle d'air de la seringue en tenant l'embout de l'aiguille et tourner vers le haut. Tenir la seringue avec la main droite le poce et l'index tenant le corps de la seringue dans une position perpendiculaire ( à un angle de 90°). Tendre la peau entre le pouce et l'index de la main gauche pour faciliter la pénetration sans douleur de l'aiguille, introduire l'aiguille d'un geste sec et rapide, lacher la peau une fois l'aiguille introduite, aspirer en tenant le piston de la seringue pour voir qu'un vaiseau sanguin n'a pas été piqué car risque d'hémorragie ou de paralysie suite à l'atteinte du nerf sciatique. Dans tous le cas, une aspiration qui ramène du sang impose directement le retrait et le changement de l'aiguille pour le piquer à un autre endroit.
Injecter lentement en tenant avec le petit doigt de la main gauche un petit morceau d'ouate imbibé d'alcool pour désinfecter le site de l'injection. Réinstaller le patient dans sa position initial, noter les soins dans le dossier, achèver la technique.
NB : une injection intramusculaire normale ne doit pas : faire très mal, faire saigner ou faire des bulles d'air, créer un hématome.
L'injection sous-cutanée ou hypodermique c'est l'introduction d'une substance médicamenteuse dans l'épiderme l'aiguille par rapport à la peau à un angle de 45° suivi d'un pincement de la peau. Sa réabsorption est lente.
Le sites d'injection sont notamment la face externe du bras, de la cuisse, de la paroi abdominale, la paroi supéro-externe de l'avant-bras ainsi que la face postérieure de l'omoplate.
Le matériels d'injection sont presque les mêmes, mais ici on doit utiliser la seringue ayant une aiguille courte, sauf devant un malade obèse.
La technique est presque la même avec celle de l'injection intramusculaire, sauf qu'il faut ici saisir l'aiguille de la seringue à un angle de 45° en pinçant toujours la peau.
Par exemple : l'injection de l'insuline.
-En cas de faute d'asepsie, il peut y avoir comme conséquence un abcèsou une infection grave.
-En cas de faute de la technique, il peut y avoir une douleur de l'aiguille ou sa rupture, un risque d'attente du nerf sciatique en cas de mauvais choix du site.
-En cas d'erreur des médicaments, risque de surdosage et de décès. Risque de d'un choc anaphylactique. Voilà pourquoi il est toujours demandé de poser la question à votre malade si il tolère la PENICILLINE-PROCAINE.
La réaction allergique peut également survenir.
On 09/09/2020
Les vitamines sont apportées par l’alimentation dans le corps humain.
Nous distinguons deux classifacations des viatamines à savoir : les vitamines liposolubles, ainsi que les vitamines hydrosolubles.
Ce sont des vitamines qui sont solubles dans les lipides. Il existe cependant quatre vitamines liposoluble appelées : Les A.D.E.K.
Elle s'appelle également Rétinol. C’est une vitamine liposoluble qui regroupe une entité naturelle contenu dans certains légumes et les fruits ayant une activité comparable à celle de rétinol, la forme active de la vitamine A.
Le rétinol est une substance chimique qui joue plusieurs rôles dans le corps humain :
- Il assure la physiologie de la vision au niveau de la rétine de l’œil.
- Il participe à la différenciation et à la multiplication des tissus en particuliers les tissus des poumons, de l’intestin et de la peau.
- Il joue le rôle d’un anti occident cellulaire, c'est-à-dire protège les différentes cellules contre leurs destructions et celle des radicaux libres dans le corps humain.
- Il protège la peau contre l’action nocive des rayons ultraviolets du soleil qui entrainent le vieillissement de la peau.
Il existe deux grandes sources de la vitamine A : source animale et végétale.
-Source animale : c’est la meilleure source contenue dans les règnes animales. Meilleure forme utilisée par l’organisme humain. Les sources animales de la vitamine A sont :
- Les dérivées de lait.
- Le lait entier ou pasteurisé.
- L’huile des poissons.
- Les foies des animaux et les œufs.
-Source végétale : elle contient la vitamine A sous forme de beta carotène ou provitamine A qui doit être transformé dans le corps humain en rétinol ou vitamine A active. Parmi les sources végétales citons les écorces des mangues, les patates douces, les persilles.
La carence en vitamine A entraine une perte définitive de la vision appelée cécité ainsi que des troubles associés notamment :
- La baisse de la vision, les lésions de la cornée, les lésions des conjonctives, l’incapacité de voir la nuit.
- Les altérations de la peau et des muqueuses.
- L’augmentation de la sensibilité aux infections respiratoires aigües.
Les rapports journaliers de la vitamine A recommandé sous forme des carotènes est de 2 mg/jour. Néanmoins, pour éviter les troubles visuels, la dose recommandé est de 500 à 1500 U.I/jour.
C’est une vitamine indispensable aux métabolismes phosphocalciques. Elle s'appelle également vitamine antirachitique.
Cette vitamine est produite naturellement. Il existe plusieurs formes de la vitamine D dans la nature à savoir :
- La vitamine D2 ou ERGO CALCIGEROL.
- La vitamine D3 ou CHOLECALCIFEROL.
La vitamine D2 est rencontrée souvent dans les végétaux, tandis que la vitamine D3 est produite par la peau humaine.
La vitamine D joue plusieurs rôles dans le corps humain entre autre :
1. Elle assure les métabolismes phosphocalciques.
2. Elle facilite la consolidation des os et la formation des tissus osseux.
3. Elle renforce les muscles.
4. C'est un élément important dans le traitement de l'ostéoporose (la perte de calcium au niveau des os), surtout chez les femmes en ménopause.
Il existe trois sources de la vitamine D à savoir :
- La source cutanée : c’est la principale source de la production de la vitamine D dans le corps humain. En effet, au niveau du denrée de l’homme, on trouve la provitamine D appelée « ERGOSTEROL » qui se transforme en vitamine D sous l’action des rayonsultra-violets du soleil.
- La source animale et végétale : ces deux sources opportent la vitamine D dans le corps humain mais à faible dose, d’où la principale source de la vitamine D reste la peau de l’homme.
Parmi les sources animales et végétales de la vitamine D on peut citer : le jaune de l'œuf, les poissons gras, l’huile tirée des foies des poissons.
Les besoins en vitamine D sont difficiles à évaluer car ils sont fonctions du degré d’exposition aux rayons solaires, c'est-à-dire plus on est exposé au soleil, plus on gagne la vitamine D, mais aussi ces besoins dépendent du degré de pigmentation de la peau.
La carence en vitamine D entraine une maladie qui affecte les os appelée RACHITISME.
C’est une vitamine liposoluble qui joue plusieurs rôles dans l’organisme :
- Elle est un antioxydant claire et protège les différentes cellules contre leur destruction par les radicaux libres du corps humain.
- Elle intervient dans le renouvellement des annexes de la peau notament les poils et autres.
- Elle prévient les maladies cardiaques et les AVC.
le besoin en vitamine E est très mineur de l’ordre d'1UI/jour.
Elle est également présente dans les sources végétales particulièrement dans les fruits.
C’est une vitamine liposoluble qui joue un rôle important dans le phénomène d’arrêt des hémorragies en agissant avec les facteurs de coagulation et les plaquettes.
La vitamine K est une vitamine anti hémorraquique.
Il existe trois formes de vitamine K dans la nature :
- La vitamine K1 ou Vitaminephylloquinone ou phytonadione : une vitamine synthétisée qu'on retrouve dans les extraits des plantes.
- La vitamine K2 ou Vitamine Menaquinote, elle est produite particulièrement par les bactéries du tube digestif de l’homme à partir de la transformation des végétaux contenu dans les aliments digérés.
- La vitamine K3 ou Menandione : synthétisée à partir de la vitamine K2.
Il existe deux grandes sources : la source endogène et la source exogène.
1. La source endogène : c’est la principale source de production à partir de l’action des bactéries du tube digestif chez l’homme sur les végétaux contenu dans les aliments digérés.
La vitamine K est absorbée au niveau de l’intestin pour être stockée au niveau du foie.
2. La source exogène : apportée essentiellement dans les aliments végétaux comme les épinards, le choux, ainsi que les carottes.
Les besoins journaliers de la vitamine K est de 15 mg à 1 mg/jour.
La carence en vitamine K entraine les maladies hémorragiques notamment le saignement au niveau du nez (épistaxis), le seignement au niveau des censives, du tube digestif et même des hémorragies célébro-meningées. Par conséquent, il faut administrer systématiquement la vitamine K1 à tous les nouveaux nés qui n’ont pas de réserve hépatique en vitamine K pour éviter les maladies hémorragiques, en raison de 1 mg/kg.
Ce sont des vitamines qui sont dissoutes dans l’H2O, et qui sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain, à des faibles concentrations dans l’organisme. Parmi les vitamines hydrosolubles nous avons :
- Les vitamines du groupe B.
- Les vitamines du groupe C.
Elles regroupent un ensemble des vitamines jouant plusieurs rôles dans l’organisme allant de la vitamine B1 à B12.
Nous distinguons :
- La vitamine B1 (THIAMINE).
- La vitamine B2 (RIBOFLAVINE).
- La vitamine B6 (PYRIDOXINE).
- La vitamine B12 (CYANOCOBALAMINE).
Le groupe des vitamines B12 a été identifié par le biochimiste Kazimierz Kunk vers les années 1910-1912. Ce savant a découvert pour la première fois la vitamine B1 dans les enveloppes du riz.
Les vitamines du groupe B assurent plusieurs fonctions dans l’organisme notamment :
- La formation de cellules sanguines (rôle joué par la vitamine B12).
- Le développement et fonctionnement du SNC et Périphérique.
- Elles forment des radicaux qui composent les enzymes, les coenzymes et les hormones.
Le besoin journalier en vitamines B est de l'ordre de 0,2 à 4 mg/jour.
Les sources des vitamines B sont : source endogène et source végétale.
- Source endogène : elle est représentée par les bactéries du tube digestif qui produisent essentiellement la vitamine B12 et la vitamine B2.
- Les sources végétales : elles sont multiples et sont représentées par les enveloppes du riz, des céréales, des légumineuses, ainsi que celles des fruits.
La carence en vitamines B entraine des manifestations cliniques variables qui sont :
- Les anémies sévères (B12).
- Les polynévrites (les inflammations des nerfs).
- Les troubles de la sensibilité et les troubles moteurs.
C’est un groupe des vitamines hydrosolubles que l’homme ne sait pas synthétiser, mais qui doivent être apporté par l’alimentation.
Leur absorption se fait au niveau de l'intestin, mais leur élimination se fait par voie urinaire.
La vitamine C est présente dans le cristallin de l’œil, les globules blancs, l’hypophyse, les glandes surrénales et le cerveau.
Les fonctions de la vitamine C dans le corps humain sont :
- La synthèse des collagènes c'est-à-dire une protéine qui participe à la constitution des tissus conjonctifs, des ligaments, des tendons musculaires et des os.
- Elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire.
- Elle active le processus de cicatrisation des places.
- Elle participe à la production des globules blancs et des globules rouges.
- Elle facilite l’absorption intestinale du fer.
- Elle a un pouvoir antioxydant qui protège la destruction des cellules entre l’action des radicaux libres du corps humain.
La vitamine C a deux grandes sources : la source animale et la source végétale.
a). Source animale : elle est représentée par le lait de vache frais et le lait maternel.
b). Source végétale : c’est la plus grande source des vitamine C représentée par les fruits frais notamment : les citrons, les oranges, les fraises, les tomates, et les légumes crus.
Les apports journaliers sont de l’ordre de : 20 mg/kg/jour chez l’enfant, et 500 à 1000 mg/jour chez l’adulte.
La carence en vitamine C entraine une maladie grave appelée Ascorbit caractérisée par le saignement des gencives et fatigabilité extrème.
On 09/09/2020
La surface corporelle est un paramètre très important et utile dans de nombreuses situations cliniques. Il est donc possible de la calculer par la formule suivante : surface cutanée = poids du patient x Taille : 3600.
Chez l’enfant, la surface corporelle est calculée par la formule suivante : surface cutanée = 4 x poids + 7 : poids + 90.
L’épaisseur de la peau varie selon les points considérés de 0.5 mm à 2 mm, à la paume des mains et à la plante des pieds 3 mm. La résistance de la peau à l’étirement est aussi considérable.
La couleur de la peau caractéristique de la race noire est due à la répartition en surface de la mélanine.
La peau comporte 3 zones distinctes à savoir : l’épiderme, le derme et l’hypoderme.
C’est la partie la plus superficielle de la peau. Elle constitue le revêtement cutané.
Elle est composée de 3 types de cellules à savoir :
• Les keratinocytes : ce sont des cellules cylindriques qui se superposent. Elles se transforment de la base à la surface pour aboutir à la couche cornée.
• Les mélanocytes : sont les cellules qui fabriquent la mélanine. Elles ont des ramifications qui distribuent la mélanine à tous les keratinocytes. Les mélanocytes sont partout dans l’épiderme.
• Les cellules de Langerhans : ce sont des cellules de défense contre les infections. Elles sont dispersées dans tout l’épiderme, et elles sont issues de la moelle osseuse. Dans le sang ces mêmes cellules s’appellent macrophages. Les cellules de Langerhans jouent un rôle immunitaire. Elles sont capables de capter les antigènes exogènes ou infectieux et de les présenter aux lymphocytes, provoquant ainsi la stimulation et l’induction d’une réponse immune.
De l’intérieur vers l’extérieur, l’épiderme comprend :
1.La couche basale ou germinative
2.Le corps muqueux de Malpighi ou la couche épineuse
3.L a couche granuleuse
4.La couche cornée qui est la couche superficielle.
La peau est constituée par : le pore de transpiration, les veines, les mélanocytes, la jonction dermo-épidermique, les artères, la terminaison nerveuse, les poils, la lande sébacé, l'épiderme, la couche cornée, le follicule pileux, le derme, la couche pigmentée, le bulbe, l'hypoderme, les keratinocytes, ainsi que les nerfs.
Elle comprend deux types de cellules :
a) Les cellules basales ou kératinocytes : ce sont des cellules cylindriques reliées les unes aux autres par de ponts intercellulairesqu’on appelle desmosomes. Ces cellules sont à l’origine de renouvellement de l’épiderme qui s’effectue en 28 jours. Elles sont en constante progression de la profondeur vers la surface. Le renouvellement de l’épiderme est accéléré et se fait en 2 jours au lieu de 28 jours on a une dermatose erythemato squameuse en plaques bien délimitées d’évolution chronique appelée psoriasis.
b) Mélanocytes : ce sont les cellules dendritiques. Il y a un mélanocyte pour 7 keratinocytes.Ces cellules secrètent un pigment appelé mélanine responsable de la couleur noire de la peau. Le nombre de mélanine est le même pour toutes les races. Les différences de couleur de la peau résultent d’une plus grande activité des mélanocytes dans certaines races .En effet, les grains de mélanine sont plus gros et situés dans la couche superficielle dans la race noire que dans la race blanche.
La quantité de mélanine d’un individu dépend de plusieurs facteurs :
• L’Hérédité.
•Les Hormones venant stimuler la mélanine notamment la mélanogénèse. Elle est sous le contrôle d’une hormone hypophysaire antérieur appelée Mélanocyte StimulatingHormon (MSH).
•Les facteurs pathologiques comme l'albinisme.
La quantité de mélanocytes varie selon les régions du corps humain :
- La région génitale : 2300/mm3
- Le visage : 2000/mm3
- Le tronc : 900-1700/mm3
La mélanine protège la peau contre les rayons solaires en particulier les rayons ultraviolets du soleil qui favorisent le processus de vieillissement de la peau et le cancer cutané. Sous l’influence du rayonnement solaire, la mélanine augmente la synthèse de la vitamine D dans la peau.
Elle constitue la plus grande partie de l’épiderme. Elle s'appelle également CORPS MUQUEUX DE MALPIGHI.
Cette couche est formée de plusieurs assises ou couches de keratinocytes qui tendent à s’aplatir de la profondeur vers la surface.
Elle est composée de deux couches de keratinocytes aplaties dont le noyau est en voie de disparition.
Elle est composée de plusieurs assises des cellules desséchées, sans noyaux. Les cellules contiennent des grains de kératine et elles sont régulièrement ordonnées comme les écailles qui forment une véritable barrière et desquament à la surface. La couche cornée est forte au niveau de la paume de mains et surtout à la plante de pied ; elle est dure et résistante à cause de la kératine que les cellules contiennent.
Il est égalemment constitué des cellules appelées fibroblastes qui fabriquent les fibres collagènes, ainsi que des macrophages, mastocytes, les plasmocytes, et histiocytes.
Les histiocytes ont un rôle de phagocytose vis-à-vis des substances étrangères et en particulier des microbes. On a aussi des cellules en provenance des vaisseaux sanguins qui sont les lymphocytes et les leucocytes.
Entre le derme et l’épiderme se trouve une jonction dermo-épidermique. C’est une mince membrane ondulée, riche en fibre de réticuline, et elle forme des saillies dans l’épiderme et ces saillies on les appelle papilles dermiques et des sillons occupés par l’épiderme qu’on appelle crêtes épidermiques.
- Energétique par la mobilisation des graisses de réserves.
- Protection mécanique qui sert d’amortisseur entre le derme et les os.
-Régulateur thermique car la graisse est isoluble dans l'eau.
-Apparence de la silhouette en fonction de l’âge, du sexe et de l’état nutritionnel.
Pour ce qui est de la sensibilité, dans le derme on trouve de corpuscules qu’on appelle corpuscules de Meissner, ils sont responsables du tact, et sont très nombreux à la pulpe des doigts. Les corpuscules de Paccini : siègent dans l’hypoderme, ils sont sensibles à la pression.
-Les corpuscules de Ruffini : sont sensibles au chaud et sont situés dans le derme.
Le sens de la douleur est sous la dépendance des terminaisons nerveuses libres. Ils siègent sous la jonction dermoépidermique.
Notons que les fibres cholinergiques sont responsables de la secrétion sudorale eccrine.
On 12/08/2020
LE DIABÈTE
Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par une augmentation de la glycémie dans l'organisme de façon pathologique.
La glycémie normale de l'homme est de 60 à 126 milligrammes par décilitre lorsque la personne est en jeun.
Il existe deux types de diabète : le diabète du type 1 et le diabète du type 2. Dans ce billet de blog, nous n'allons parlé que du diabète de type1.
La différence entre le diabète du type 1 et le diabète du type 2 repose sur : les antécédents, l'âge de survenu, le mode de début, les facteurs déclenchants, la symptomatologie ainsi que le poids du patient.
Dans le diabète du type1 les antécédents sont rares tandis que dans le type2 les antécédents sont fréquents. Le diabète du type1 survient avant 35 ans (d'où l'appellation de diabète juvénile), tandis que le diabète du type2 survient après 35 ans. Le début du diabète de type1 est rapide et explosif, tandis que le début du diabète de type2 est très lent et insidieux. La symptomatologie du diabète de type1 est bruyante, dans le type2 elle est pauvre et parfois absente. Dans le diabète du type1 le poids du patient souvent normal ou alors le patient est très maigre. Tandis que le diabète du type2 est un diabète des sujets obèses.
Dans le diabète du type1 l'hyperglycémie au diagnostic est superieure à 3g/l par rapport à la valeur de référence, dans le type2 par contre, l'hyperglycémie est inférieure à 2 par rapport à la valeur de référence.
Dans le diabète du type1 il y a la présence des corps cétoniques dans les urines du patient, dans le type2 il y a en pas.
Enfin, la cause de la mort dans le diabète du type1 c'est l'insuffisance rénale tandis que dans le type2 c'est surtout les maladies cardiovasculaires. Le cas de l'hypertension artérielle par exemple. C'est ça la différence.
Le diabète du type1 est caractérisé par une carence absolue en insuline. Cette carence est due le plus souvent à la destruction des cellules béta pancréatiques dont le mécanisme habituel est l'auto-immunité. On a supprimer l'appellation du diabète insulino-dépendant puisque certaines formes de diabète de type1 n'exige pas necessairement une insulino-thérapie.
Selon l'American Diabetes Association, il existe deux sortes de diabète de type1 à savoir :
- Le diabète LADA : auto-immun.
- Le diabète idiopathique.
Le diabète idiopathique est un diabète caractérisé par l'absence d'auto-anticorps, présents surtout chez les noires. Tandis que le diabète LADA est caractérisé par une phase de remission, d'où l'appellation du diabète insulino-dépendant.
Nous distinguons plusieurs : les facteurs génétiques, ainsi que les facteurs environnementaux.
Le diabète du type1 est souvent une prédisposition génétique même si les antécédents sont absents dans la majorité des cas.
Certaines substances alimentaires telles que l'introduction trop précoce des protéines du lait de vache ont été suspectées comme étiologies du diabète de type1. Mais aussi, la théorie hygiéniste, c'est-à-dire les gens qui sont très propres, protégés par les vaccins et qui vivent une vie sédentaire seraient exposés au diabète.
Les principaux auto-antigènes ciblés par la réponse auto immune pour entrainer le diabète de type1 sont :
- L'insuline et la pro-insuline
- La décarboxylase de l'acide glutamique (GAD)
- L'islet antigen number2 apparenté à une tyrosine phosphatase.
La lésion pancréatique est appelée insulinite (inflammation de l'îlot de Langerhans), le siège de la destruction des cellules béta par les lymphocytes cytotoxiques. Le diabète de type1 étant une maladie à médiation cellulaire faisant intervenir le lymphocytes T, et les cytokines macrophagiques.
Les anticorps circulants et détectables lors dans 95% au diagnostic du diabète de type1 sont :
- Les anticorps anti-îlots (Les ICA).
- Les anticorps anti-GAD
- Les anticorps anti-IA2
- Les anticorps anti-insulines
Les anticorps anti-insulines sont observés surtout chez les sujets âgés et de moins de 15 ans. Tandis que les anticorps anti-GAD s'observent à tout âge et persistent toute la vie durant.
Les signes du diabète de type1 sont : le syndrome polyro-polydipsie, la polyphagie, ainsi que l'amaigrissement. Il s'agit d'un syndrome cardinal.
À part ces symptômes, il existe également : les troubles visuels transitoires tels que les anomalies de la réfraction observées dans les jours qui suivent la normalisation de la glycémie après introduction de l'insuline.
- La fonte musculaire de quadriceps.
- Élévation de la glycémie.
- Glycosiurie massive.
- Cétonurie.
Le diabète de type1 évolu en trois phase :
* La phase préclinique : où les mécanismes immuns détruisent les cellules bêta des îlots de Langerhans.
* La phase clinique : correspondant à la destruction de plus de 85% de la masse des cellules bêta.
* La phase séquellaire : où les cellules restantes seraient appelées à disparaître complètement.
Les principes généraux pour la prise en charge du diabète de type1 sont notamment l'éducation thérapeutique visant à l'auto immunisation du patient. D'où, le transfert des connaissances par l'enseignement collectif ou individuel, la vérification des comportements, l'importance des consultations infirmières et diététiques.
- Pratiquer une insulinothérapie pour réduire l'hémoglobine glyquée, retarder et réduire la gravité des complications micro et macroangiopathiques.
L'insulinothérapie intense augmente le risque d'hypoglycémie sévère. D'où le respect du protocole de prise en charge.
Les analogues de l'insuline de durée d'action courte ou longue ont le mérite de diminuer le risque d'hypoglycémie sévère chez les diabétiques.
Dans tous les cas, éviter de faire peur au malade puisque vivre avec un diabète n'est pas simple. Il faut gagner la confiance du malade et lui expliquer que le diabète est une maladie incurable. Néanmoins, si vous respectez le traitement et le régime alimentaire approprié aux diabétiques, vous allez vivre comme tout le monde et vous ne mourrez pas longtemps.
Nous distinguons différentes variétés d'insuline d'usage courant notamment l'insuline recombinante, ainsi que les analogues de l'insuline.
Les analogues de l'insuline sont des produits modifiés pour obtenir des propriétés pharmacodynamiques intéressantes. Il existe les analogues d'action longue et les analogues d'action courte.
Les analogues rapides sont obtenus par la modification de la molécule participant à la formation des hexamères d'insuline.
Les analogues d'action lentes sont obtenus soit en modifiant le point isoélectrique de la molécule. Par exemple : le Lantus : c'est une insuline parfaitement soluble qui a un Ph acide, précipitant au Ph physiologique pour former un dépôt sous-cutané à libération lente. Ces analogues peuvent soit s'obtenir en formant un analogue acylé susceptible d'être absorbé par l'albumine et ralenti dans la solubilisation. Exemple : Lévemir.
Les analogues d'action rapide ont l'avantage d'être rapidement actif au moment de la prise alimentaire et de ne pas persister pendant la phase interprandiale. Ils sont injectés juste avant de passer à table. Tandis que les analogues lents ont une action prolongée, sans pic d'activité et ils sont relativement reproductibles d'un jour à l'autre. Ils sont administrés en une ou deux injections à heure fixe.
Ces analogues sont toujours concentrés à 100U/mL et leur durée d'action est différente. Les analogues rapides ont une durée daction de 3 à 5 heures. Exemple : Novo Rapid, Actrapid, Insuline rapide de Lilly ou Insuman. Ces insulines couvrent les besoins prandiaux.
Il existe également des insulines humaines ralenties par protamine, d'action prolongée avec une durée d'action de 24 heures ou plus. Par exemple : Ultraltard, le Neutral Protamine Hagedom (NPH) qui a une durée d'action de 9 à 16heures.
Il existe aussi des analogues mixtes, Humalogue mix 25 ou 50 par exemple. La dose généralement recommandée pour toutes les insulines est de 1UI/kg de poids corporel.
NB : Avant de donner toute forme d'insuline, on doit dabord vérifier la glycémie du patient et avertir le patient de prendre son répas. Savoir si le patient a déjà mangé permet de lui éviter la chute totale de la glycémie qui peut conduire au coma hypoglycémique ou à la mort.
Mieux vaut une hyperglycémie qu'une hypoglycémie chez le diabétique.
Les insulines s'administrent toujours en sous-cutané. Sauf dans le cas où vous vous trouvez devant un malade qui a une connaissance bidon et qui refuse le traitement insulinique pendant que son état est inquiétant, que vous voulez peut être soulager sans qu'il le mettre au courant. Dans ce cas, vous pouvez maintenant mettre l'insuline dans la perfusion. Mettez votre insuline 10 ou 20UI dans une solution physiologique et faire couler lentement votre perfusion. Pas dans un sérum glycosé.
On 14/06/2020
Ce fut ma première patiente à réssisciter. Ma première malade à guérir en urgence juste après mon stage professionel.
C'était un certain dimanche dans le quartier, tu ne pouvais jamais imaginer.
C'était vers onze heures, heure pile à Paris, je dormais torce-nue dans ma chambrette, derrière la maison, porte et fenêtres toutes ouvertes. Tous les rideaux brabellaient.
J'entendis une voix très belle appelant au sécours. C'était la voix de ma voisine, une petite fille de 5 ans qui ne cessait pas d'appeler : "Infirmier au sécours !, ma sœur est tombée et tout à coup ne bouge et ne parle plus, venez nous aider. Nous avons faites tout ce que nous pouvions, mais elle démeure endormie". C'étais la voix de la fille de ma voisine.
Je lisais un chapitre sur les convulsions fébriles, nouvel gradué en soins infirmiers, je croyais que ma tête était encore bidon...
On 03/06/2020
C'est une habitude et un besoin de prendre régulièrement un médicament qui provoque une grande tolérance ou une accoutumance au produit utilisé.
La toxicomanie apparait lors de la prise régulière d'analgésiques majeurs du genre Morphine ou d'autres substances telles que les barbituriques, les somnifères, l'alcool éthylique, la nicotine du tabac, la cocaïne, et le chanvre indien. Ces substances provoquent pendant quelques heures une sensation artificielle de bien-être (euphorie) et lorsque cette sensation artificielle de bien-être se termine, ces substances laissent des malaises, des troubles physiques et psychiques parfois sévères et un grand désir d'en prendre encore (état de besoin).